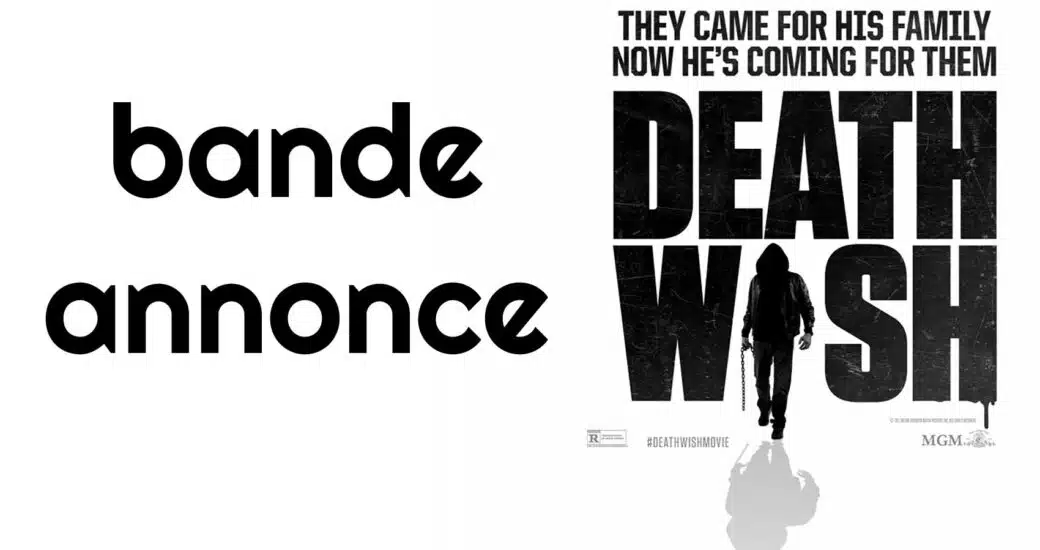Avec Death Wish, remake d’Un justicier dans la ville, Bruce Willis a l’impression d’être au purgatoire, nous aussi. Purge garantie.
Synopsis : Quand il ne sauve pas des vies, Paul Kersey, chirurgien urgentiste, mène une vie de rêve, en famille, dans les beaux quartiers de Chicago… Jusqu’au jour où tout bascule. Sa femme est sauvagement tuée lors d’un cambriolage qui tourne mal… Sa fille de 18 ans est plongée dans le coma. Face à la lenteur de l’enquête, il se lance dans une chasse à l’homme sans merci.
Critique : Réalisé par Eli Roth, l’un des cinéastes les plus roublards de Hollywood, serviteur du cinéma bis avec les pieds, le remake d’Un justicier dans la ville est une bévue de plus dans la carrière du cinéaste qui enfile les déceptions et les non-événements, quel que soit le genre abordé (la fausse résurrection du film de cannibale avec Green Inferno, le home invasion au féminin avec Knock Knock). Exit les outrances du torture porn Hostel qui le révéla : Roth s’est assagi, y compris quand il s’agit de faire renaître de ses cendres le parangon du vigilante movie, le film de Michael Winner Un justicier dans la ville, avec Charles Bronson, produit par Dino De Laurentiis. Cette série B de 1974 au succès colossal allait donner naissance à une armada de suites de pure exploitation, notamment produites par la Cannon Inc du duo Golan Globus. Pour remplacer Bronson, rien de tel qu’un vieux routier de l’action flick dont on n’a pas eu de nouvelles au box-office depuis des lustres, l’inénarrable Bruce Willis en l’occurrence.
Bruce Willis routard de la série B ringarde
Inexpressif, même dans le chagrin, alors que deux malfrats ont buté son épouse (Elizabeth Shue, second rôle kleenex vite évacuée) et sa fille, dans le coma, Bruce Willis au charisme déclinant depuis plus de vingt ans, a rarement paru aussi peu investi à l’écran. Premier rôle, il se contente de faire acte de présence dans un téléfilm policier du samedi soir qui multiplie les balles perdues, incapables de toucher sa cible. TF1 diffusera toutefois le film en prime time, un dimanche soir…
Death Wish rate toute ses cibles
Vieillot, jusque dans les split screens censés livrer un hommage aux classiques des seventies, le remake ne démarre sa politique de vigilante qu’au bout de quarante minutes pour quelques échanges de balles en territoire urbain qui ne laissent aucun doute sur l’inutilité de l’intrigue.
Avant cela, il faut notamment aux spectateurs pouvoir survivre à la parodie de la famille heureuse à laquelle se livrent Willis, chirurgien de son état, sa belle épouse et sa charmante fille. Tant de bonheur forcé pour des destins brisés nous cloue le bec dans sa naïveté.
Une fois le crime commis, Willis devient le parangon du deuxième amendement américain, milice vengeresse à lui tout seul. Sous une capuche d’ado, la silhouette de Bruce Willis veille sur la veuve et l’orphelin et devient la nouvelle figure de la mort américaine, un ange gardien au service de la NRA, après une séance de shopping dans une armurerie dont on peine à comprendre l’ironie du message.
Au grand dam de la police, dont on se contrefiche de l’enquête menée en parallèle, puisqu’ils sont, de toute façon, du côté du veuf éploré, y compris dans l’obscénité de ses assauts, le personnage de Paul Kersey assène sa vengeance malsaine avec quelques séquences outrancières dont on sent les coupes que le cinéaste a accordées au studio MGM pour une exploitation plus sereine. En France, c’est Paramount qui distribuera le film ayant longtemps traîné sa carcasse en 2018, avant de sortir aux USA chez MGM en Amérique du Nord et chez Paramount Pictures en France. En Chine, le polar urbain sera amputé de dix minutes.
Un échec relatif au box-office
L’exploitation du film fut ratée en France. Proposé en contre-programmation de l’actualité cannoise, Death Wish reste à peine six semaines en salle, avec tout juste 240 000 entrées. Aux USA, deux mois plus tôt, le vigilante parvenait tout juste à rembourser les frais de production s’élevant à 30 000 000 de dollars.
Production anachronique, Death Wish ne pouvait même pas disposer des arguments vendeurs de ce type de polar burné, faisant écho au politiquement correct de son époque. Révisé par son distributeur, le visuel érige Bruce Willis superstar, non plus le flingue à la main, celle-ci a été ni plus ni moins effacée (sic), mais pointant, en lieu et place de l’arme, des doigts difformes évoquant ceux monstrueux de James Woods dans Vidéodrome (David Cronenberg, 1984). Carrément laid.
Au final, Death Wish est artistiquement tellement médiocre, que l’on n’aura même pas besoin d’égratigner son conservatisme pour l’abattre de quelques coups de plume. Le navet est intégral et, contrairement à l’original, ne nécessitera aucun sequel pour tomber plus bas : on creuse déjà ici les limites du tolérable.
Critique de Frédéric Mignard